30/2023 : Là où chantent les écrevisses
(Delia Owens)
 Quand on parle de « roman américain », beaucoup d’idées nous viennent à l’esprit, plus ou moins fausses, plus ou moins caricaturales. Mais parfois, un titre en particulier parvient à réunir tant de caractéristiques que l’on associe à cette culture qu’il en devient emblématique. « Là où chantent les écrevisses » fait partie de ces titres, et je veux croire qu’au-delà de son efficacité narrative, ce sont ces particularismes qui l’ont placé si longtemps en tête des meilleures ventes de l’autre côté de l’Atlantique.
Quand on parle de « roman américain », beaucoup d’idées nous viennent à l’esprit, plus ou moins fausses, plus ou moins caricaturales. Mais parfois, un titre en particulier parvient à réunir tant de caractéristiques que l’on associe à cette culture qu’il en devient emblématique. « Là où chantent les écrevisses » fait partie de ces titres, et je veux croire qu’au-delà de son efficacité narrative, ce sont ces particularismes qui l’ont placé si longtemps en tête des meilleures ventes de l’autre côté de l’Atlantique.
Résumer l’intrigue à un crime et sa résolution serait passer à côté de l’essentiel, mais la base de l’histoire est bien là : En 1969, dans un environnement défavorisé, la « fille des marais », Kya, vit seule et plus ou moins illégalement dans un mobile home bricolé et attise toutes les rumeurs de sauvagerie — de sorcellerie, presque ! Un jour, on retrouve le corps de Chase Andrews, un habitant du village voisin, au pied d’une tour de guet. Accident ou meurtre, la police locale finit par trancher, car la scène du meurtre a visiblement été trafiquée. Les histoires passées ressurgissent alors, et la jeune Kya finit par être suspectée. Elle ne peut compter que sur une poignée d’alliés pour prouver son innocence.
Étalée de 1950 à 1970, cette histoire met donc en scène une enquête, mais surtout un personnage particulier, cette Kya Clark, orpheline, autodidacte, farouche, connaissant le marais comme sa poche, artiste capable de saisir par le dessin la nature environnante, seule, très seule, mais autonome et sauvage. L’essentiel du roman couvrira l’enquête et le procès (le catégorisant dans les procedurals, ces romans qui se délectent d’un système judiciaire pas toujours évident à comprendre), mais on y trouve aussi d’autres thèmes forts du roman américain : le nature-writing, tout d’abord, avec l’exaltation du marais. La défiance de l’individu face au groupe (ou plutôt, le fait de ne faire partie d’aucun groupe qu’on n’aura pas choisi consciemment), la défiance vis-à-vis d’un gouvernement lointain (qu’il faut peut-être chercher dans les origines sudistes — la Géorgie, comme Harper Lee – de l’auteure), le droit de faire justice soi-même, le droit à la marginalité et à la solitude, etc.
Au-delà de ces thèmes infusés, et sans chercher aussi loin, le roman est également particulièrement poignant et tendu : le compte à rebours du procès fait monter l’enjeu tandis que les flashbacks permettent tantôt de privilégier l’innocence et la culpabilité de Kya. Mais plus que les faits et les preuves — plutôt absentes — ce sera la personnalité de Kya qui sera étudiée à la loupe. Le lecteur aura pour cet aspect des éléments que les témoins, majoritairement bourrés de préjugés, n’auront pas, ou ne voudrons pas voir. Le roman culmine évidemment avec le verdict que je ne dévoilerai pas.
L’axiome « nature = bienveillance, société = danger » qui est souvent développé par les philosophes naturalistes de l’école américaine trouve ici une nouvelle incarnation, tant les aller-retours entre la solitude des marais (que ne renierait pas Thoreau) et la « ville », représentée par le commerce, la police, les tribunaux et les « autres » sont contrastés. Et au milieu de tout ça tente d’exister, comme une perversion nécessaire, les thèmes de l’amour et du contact physique, qui donneront au récit la coloration holistique qui lui manquait.
C’est donc bien la richesse de ses thèmes et leur interconnexion parfaitement maîtrisée qui ont permis à Delia Owens – biologiste de formation – de créer un nouveau grand romand américain. Un niveau qu’il lui sera difficile d’égaler.
29/2023 : L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage
(Haruki Murakami)
 Il y a longtemps maintenant, Tsukuru Tazaki faisait partie d’un cercle d’amis. Des amis comme on s’en fait à l’université : des amis passionnés, des amis présents, vivants, fusionnels. Tous, sauf Tsukuru, partageaient un point commun : une partie de leur nom évoquait une couleur. Mais Tsuruku était l’incolore, pas moins membre du groupe, pas moins présent — quoique… Et puis un jour, Tsuruku quitte le groupe pour partir étudier ailleurs et sa vie prend une autre direction. Jamais plus il ne parlera aux autres, après avoir enfoui dans sa mémoire l’humiliation d’un rejet incompréhensible. « Désolé, mais nous ne voulons plus que tu nous téléphones désormais », a dit Bleu. Et Tsuruku a raccroché, tétanisé. Des années plus tard, alors que Tsuruku rencontre Sara, celle-ci rejette ses avances, car Tsuruku a une blessure qui n’a pas cicatrisé. Elle l’enjoint de comprendre l’origine de cette blessure. Commence alors pour Tsukuru un retour vers son passé et ses mystères, comme un parcours initiatique à retardement.
Il y a longtemps maintenant, Tsukuru Tazaki faisait partie d’un cercle d’amis. Des amis comme on s’en fait à l’université : des amis passionnés, des amis présents, vivants, fusionnels. Tous, sauf Tsukuru, partageaient un point commun : une partie de leur nom évoquait une couleur. Mais Tsuruku était l’incolore, pas moins membre du groupe, pas moins présent — quoique… Et puis un jour, Tsuruku quitte le groupe pour partir étudier ailleurs et sa vie prend une autre direction. Jamais plus il ne parlera aux autres, après avoir enfoui dans sa mémoire l’humiliation d’un rejet incompréhensible. « Désolé, mais nous ne voulons plus que tu nous téléphones désormais », a dit Bleu. Et Tsuruku a raccroché, tétanisé. Des années plus tard, alors que Tsuruku rencontre Sara, celle-ci rejette ses avances, car Tsuruku a une blessure qui n’a pas cicatrisé. Elle l’enjoint de comprendre l’origine de cette blessure. Commence alors pour Tsukuru un retour vers son passé et ses mystères, comme un parcours initiatique à retardement.
Sommes-nous tous marqués à ce point par notre passé que ce genre de romans crée aussi facilement des échos dans nos esprits ? Peut-être avons-nous tous l’une ou l’autre cicatrice, plus ou moins refermée, que nous grattons régulièrement sans même nous en apercevoir. Chez Murakami, les faits se mélangent aux rêveries, l’histoire devient tantôt fantasque, tantôt profonde, mais l’auteur nous fait systématiquement vivre un voyage intérieur. Les lieux n’ont pas de sens, les personnages à peine davantage, mais le cheminement intérieur, entre méditations, surprises, dénis et sidérations, dessine un plan que le lecteur peur suivre les yeux fermés. Le fantastique débarque au détour d’une page, mais n’a pas plus de sens qu’un ressenti face à une couleur, qu’un soupir entendu dans le vent. Il n’est qu’une ponctuation de plus, une expérience, où ce qui compte est moins le sens du moment que la signification dont on finit par charger — ou pas — l’événement.
Ce serait sans doute une erreur de chercher un message dans les textes de Murakami. Ils sont plus proches d’une estampe produite par un artiste et devant laquelle on s’interroge que d’un mode d’emploi technique. Rorschach n’est pas loin, même si on pense plutôt à une méditation guidée, à une promenade pleine de surprises, mais destinée à nous mener à un certain équilibre. Il semble y avoir chez Murakami une obsession de l’homéostasie, du retour à la normale — qui ne préfigure généralement qu’un nouveau déséquilibre.
Le voyage de Tsukuru à la rencontre de ses anciens amis ne le changera pas vraiment, au fond. Ses découvertes vont certainement le surprendre, mais sans changer le fond de sa personnalité. Elles vont cependant le faire passer d’une vie grise et anesthésiée à une vie dans laquelle il choisira les questions qu’il veut se poser. Une vie toujours incertaine, toujours neutre, mais vécue. C’est la véritable évolution que nous promet ce voyage. Parvenir à décider de ne pas décider. Et ça, ce n’est pas le message habituel des romans que l’on a l’habitude de lire, et c’est ce qui fait que Murakami est une voix à part dans la littérature. Une autre expérience.
28/2023 : La cabane aux confins du monde
(Paul Tremblay)
 Retour à Gallmeister, que j’avais un peu trop délaissé, en raison des nombreux autres livres inscrits sur ma pile « à lire absolument ». Et pour ce retour, quelle chance ! Je tombe directement sur une pépite. Je ne connais pas le moins du monde Paul Tremblay et je n’ai pas l’habitude de me fier aux commentaires dithyrambiques d’auteurs célèbres sur la quatrième de couverture, même (surtout !) si cet auteur célèbre est Stephen King. Mais le bandeau « le prochain film de M. Night Shyamalan » a peut-être joué dans mon achat, par curiosité, même si le réalisateur est capable du meilleur comme du pire.
Retour à Gallmeister, que j’avais un peu trop délaissé, en raison des nombreux autres livres inscrits sur ma pile « à lire absolument ». Et pour ce retour, quelle chance ! Je tombe directement sur une pépite. Je ne connais pas le moins du monde Paul Tremblay et je n’ai pas l’habitude de me fier aux commentaires dithyrambiques d’auteurs célèbres sur la quatrième de couverture, même (surtout !) si cet auteur célèbre est Stephen King. Mais le bandeau « le prochain film de M. Night Shyamalan » a peut-être joué dans mon achat, par curiosité, même si le réalisateur est capable du meilleur comme du pire.
Allons ! J’ouvre le livre. Et là, je tombe directement sur un des meilleurs premiers chapitres qu’il m’ait été donné de lire. Une cabane, au fond des bois, loin de la civilisation. Devant, une petite fille, Wen, joue avec des sauterelles. À l’arrière, ses deux papas prennent des vacances bien méritées et lézardent au soleil. Puis arrive Léonard, un bon gros géant. L’homme entame une discussion avec Wen et tout est amical, calme, paisible. Mais Leonard est un étranger, et bientôt, trois autres étrangers arrivent. Et Wen prend peur et se barricade dans la cabane. Avec raison. Les quatre intrus s’en défendent, mais leurs attitudes sont menaçantes. Ils viennent avec la pire des propositions. Une décision que doit prendre la petite famille. A la fois simple et cruelle : l’un d’entre eux doit être sacrifié pour sauver le monde. A eux de choisir. Ou de sacrifier le monde.
Tandis que le huis-clos avance, des questions se posent : qui sont ces quatre intrus ? Que croient-ils ? Et s’ils avaient raison ? C’est sur cette trame que Tremblay tisse un thriller efficace, déchirant et édifiant, sur la fin du monde et la foi, sur les responsabilités et la folie, sur la survie et l’amour.
En réussissant à doser parfaitement les étapes de cette « pris d’otage », en donnant vie aux différents personnages, en mettant en scène un couple gay et leur enfant adoptif sans sombrer dans la caricature, Tremblay réussit ce que Stephen King a parfois réussi lui-même : happer le lecteur dans une intrigue qui le pousse vers la fin tout en redoutant cette fin. Et sans mettre en place de vrais méchants ou des situations horrifiques. Ici, la vraie horreur vient du libre-arbitre des personnages, prisonniers de leurs croyances et devant malgré tout les dépasser pour espérer une fin heureuse. Mais heureuse pour qui ?
Huis-clos psychologique, terrain de jeu pour des acteurs subtils, faux semblants et twists réguliers, on comprend très bien pourquoi Shyamalan a jeté son dévolu sur cette histoire menée avec une tension incroyable. On se souvient à la lecture de cette scène d’Incassable où le fils menace de tirer sur son père pour « prouver » qu’il est immortel (alors qu’aucune certitude n’existe à ce sujet) et on retrouvera plusieurs scènes de la même intensité dans ce roman. Bref, c’est une lecture passionnante et sidérante, avec un final qui fait débat, mais me semble très intelligent et presque philosophique. Encore une très belle publication dans cette collection Totem que j’adore. Et cette couverture !
27/2023 : Un étranger au village / Corps noir
(James Baldwin, Teju Cole)
 En 1951, l’auteur afroaméricain James Baldwin se retrouve, au gré des aléas de sa propre vie, dans un village de Suisse appelé Leukerbad. Rapidement, il se rend compte qu’il est sans doute le premier noir que la plupart des Américains voient de leur vie, en témoigne la réaction des enfants, interloqués, curieux et inquiets, mais aussi les regards qui ne cessent de tomber sur lui quand il se promène dans le village. Malgré tout, Baldwin différencie énormément cette expérience de celle qu’il vit dans son propre pays, où il n’est pas étranger, mais malgré tout marginalisé par la société et l’angle mort des blancs américains. De cette expérience, il tirera un texte dans lequel la méditation individuelle oblique bientôt vers la colère rentrée et l’exaltation d’une pensée qui révèle une injuste profonde.
En 1951, l’auteur afroaméricain James Baldwin se retrouve, au gré des aléas de sa propre vie, dans un village de Suisse appelé Leukerbad. Rapidement, il se rend compte qu’il est sans doute le premier noir que la plupart des Américains voient de leur vie, en témoigne la réaction des enfants, interloqués, curieux et inquiets, mais aussi les regards qui ne cessent de tomber sur lui quand il se promène dans le village. Malgré tout, Baldwin différencie énormément cette expérience de celle qu’il vit dans son propre pays, où il n’est pas étranger, mais malgré tout marginalisé par la société et l’angle mort des blancs américains. De cette expérience, il tirera un texte dans lequel la méditation individuelle oblique bientôt vers la colère rentrée et l’exaltation d’une pensée qui révèle une injuste profonde.
En 2014, Teju Cole, américain également, mais originaire du Nigeria, revient dans ce même village, avec le texte de Baldwin en tête. Il mesure les évolutions du monde, la présence désormais plus affirmée des noirs dans la culture, la musique, le cinéma. Mesure aussi que dorénavant, les noirs aussi ont infusé leur culture dans le grand melting-pot mondial, tout en observant qu’il reste encore un long chemin à parcourir, que cette réussite n’efface pas un traitement toujours et peut-être éternellement différencié, sur la base d’une seule différence de pigmentation. Le « Corps noir », comme élément de base du jugement. Avec admiration envers son aîné, il déambule à son tour dans une méditation sur ce que c’est d’être noir parmi les blancs.
Deux textes courts (moins d’une trentaine de pages) en vis-à-vis qui invitent à la réflexion, sans violence, simplement en faisant un constat et en demandant : « pourquoi ? ». Une lecture par conséquent nécessaire, qui m’invite à poursuivre une lecture engagée des romans afroaméricains ainsi que l’étude de ce point inflexible, cette tare américaine, celle de l’esclavage et de la perception des non-blancs. Un mal fondamental qui ronge la société américaine et qu’elle ne semble pas parvenir à dépasser, si j’en crois les multiples faits-divers qui parviennent jusqu’à nous dans les médias. Et qui prouvent que cette réflexion est d’une intense actualité, malgré les années qui passent.
26/2023 : Scarlett
(François-Guillaume Lorrain)
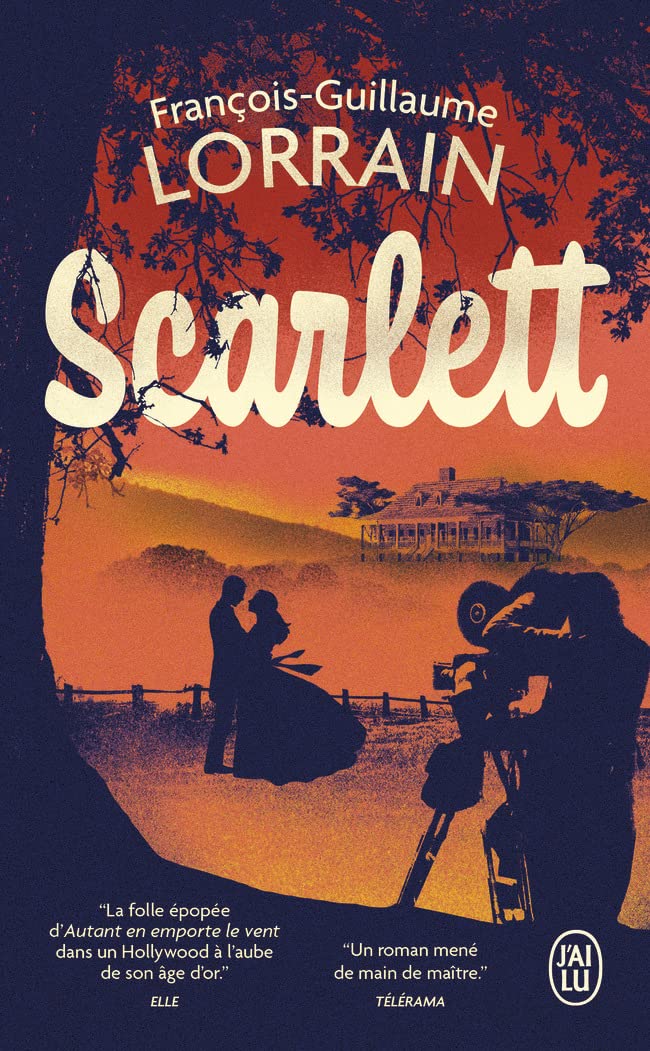 C’est une petite friandise, un livre glissé dans la PàL par hasard, à cause de son sujet qui fait une sorte de « suite » à mes lectures de « Autant en emporte le vent ». Scarlett raconte l’histoire mouvementée de la fabrication du célèbre film hollywoodien tiré du best-seller sudiste. Sous la forme romancée de petites scénettes chronologiques, l’auteur nous fait vivre les tractations de l’ombre, les intrigues des grands studios, le casting compliqué et la réception du film, le tout en prenant comme point focal le célèbre producteur David O. Selznick qui ne profitera guère du succès du film, si ce n’est dans le cadre de son estime personnelle.
C’est une petite friandise, un livre glissé dans la PàL par hasard, à cause de son sujet qui fait une sorte de « suite » à mes lectures de « Autant en emporte le vent ». Scarlett raconte l’histoire mouvementée de la fabrication du célèbre film hollywoodien tiré du best-seller sudiste. Sous la forme romancée de petites scénettes chronologiques, l’auteur nous fait vivre les tractations de l’ombre, les intrigues des grands studios, le casting compliqué et la réception du film, le tout en prenant comme point focal le célèbre producteur David O. Selznick qui ne profitera guère du succès du film, si ce n’est dans le cadre de son estime personnelle.
Bien sûr, l’exercice est toujours sujet à critiques : quand on prête des pensées à des personnages ayant existé, on extrapole toujours un peu, peu importe si on se base sur des dizaines d’articles et de « mémoires ». Pourtant, le livre est criant de réalisme : on voit que les histoires d’argent et de pouvoirs se mélangent abruptement entre des studios de production plus ou moins amis (tant de films mettent en scène ces rivalités, mais aussi les romans d’Ellroy du quatuor de L.A. et tant d’autres). Oh, il faut aussi compter sur la vanité des stars, leurs acquis inébranlables, le traitement de leur image, leur intérêt pour la prise de risque. Clark Gabble en prend pour son grade, et Vivien Leigh resplendit avant de sombrer dans la folie. Passage obligé par les aspects sociaux : comment traiter un roman faisant l’apologie du sud d’avant la guerre à une époque où les acteurs noirs commencent à subir des pressions pour cesser de servir (dans tous les sens du terme) de la soupe aux blancs. Et enfin, les médias, la réception du public, le marketing.
On le voit, la force du livre est d’être assez exhaustif dans ses thèmes et on se laisse facilement entraîner dans la « saga derrière la saga ». Avec ce livre, on mesure un peu mieux tous les obstacles qui se dressent entre un projet et sa réalisation, et compte tenu du sublime (à sa sortie, évidemment, car aujourd’hui, on critiquerait le film avec beaucoup plus de recul) du résultat, on mesure que les chefs-d’œuvre du cinéma doivent parfois beaucoup au hasard ou à la foi d’un petit groupe d’hommes.
Alors bien sûr, « Scarlett » n’est pas une grande œuvre, le format et le style ne révolutionnent rien. Mais qu’il est plaisant de découvrir l’envers du décor. Le livre m’a donné envie de revoir le film, avec une nouvelle lecture, celle des coulisses. Mais bon… quatre heures, tout de même ! Plus qu’il ne m’a fallu pour lire ce livre (mais moins que le roman de Margaret Mitchell, évidemment).
25/2023 : Les oiseaux du temps
(Amal El-Mohtar, Max Gladstone)
 Ce livre a obtenu le prix Hugo et le prix Nebula, deux des prix les plus prestigieux dans le domaine de la SF. Vous vous êtes parfois demandé à la lecture d’un livre primé ce que les jurys ont tenté de distinguer par leur attribution ? Prix Hugo : « meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy de l’année écoulée. Prix Nebula : « l’œuvre de science-fiction ou de fantasy jugée la plus novatrice ». Alors forcément, à la lecture, on se met un peu dans la peau d’un juré, et on évalue…
Ce livre a obtenu le prix Hugo et le prix Nebula, deux des prix les plus prestigieux dans le domaine de la SF. Vous vous êtes parfois demandé à la lecture d’un livre primé ce que les jurys ont tenté de distinguer par leur attribution ? Prix Hugo : « meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy de l’année écoulée. Prix Nebula : « l’œuvre de science-fiction ou de fantasy jugée la plus novatrice ». Alors forcément, à la lecture, on se met un peu dans la peau d’un juré, et on évalue…
« Les oiseaux du temps » est une oeuvre courte (200 pages). Elle met en scène deux combattantes, Bleu et Rouge, qui mènent, pour leurs camps respectifs, une guerre le long du Temps, avec en vue une victoire totale. Les guerrières sont envoyées dans des instants clés de la ligne historique, afin de provoquer le Changement qui aura un impact décisif sur les Brins de l’histoire. Mais chaque combattante a la surprise de découvrir sur place une lettre, sous différentes formes toutes plus exotiques les unes que les autres, laissée par leur adversaire. Cette espérance du contact va rapidement se transformer en échange épistolaire, en confidences et introspections, et – finalement – en amour. La nature de Bleu et Rouge restera toujours floue et indéterminable, de même que les camps pour lesquels ils combattent (« Jardin » d’un côté, « l’Agence » de l’autre, sorte d’allégorie entre la nature et l’organisation civilisationnelle, mais pas que), mais leurs points communs (elles combattent) les rapproche plus que leurs différences (une cause à laquelle aucune des deux ne croît vraiment).
Les lettres s’échangent dans des environnements étranges, des séquences clés parfois connues, parfois imaginaires situées sur des lignes temporelles exotiques. Les lettres elle-même sont cachées comme des messages secrets. Bien sûr, très rapidement, les deux combattantes deviennent des renégates, après avoir épuisé leur motivation dans de vains combats, même si chacune a suffisamment de fierté pour « bien faire » son travail. Reste que tant qu’elles seront vivantes, elles seront ennemies. Difficile pour des amoureuses. Mais qu’à cela ne tienne, la solution est presque dans le problème…
Alors, on le voit : pour sa poésie, pour ses environnements étranges, pour sa mise en scène, sa forme, sa structure, le livre mérite amplement son prix Nebula. Mais je me suis tout de même un peu ennuyé lors de la lecture : les environnements hors sols ne se rattachent à rien. La poésie cache les faits, ne permettant pas de comprendre les faits d’arrière-plan, les enjeux du combat, ses protagonistes, ses méthodes. En focalisant sur les échanges, les auteurs signent évidemment un roman d’amour plus que SF, mais le manque de différence dans les personnalités de Bleu et Rouge finissent par amalgamer tout le récit, en tout cas en ce qui me concerne. Au bout d’un moment, je ne savais pas qui était Rouge, qui était Bleu, dans quels camps ils étaient, à qui c’était le tour d’écrire, etc. Alors, on lit, car le livre est court. Et la fin m’a semblé un peu naïve, un peu facile, même si elle était, il est vrai, annoncée par des détails durant tout le récit (l’avantage d’un livre sur le voyage dans le temps est qu’on se soucie peu de l’ordre des événements). Mais le prix Hugo… eh bien, je ne sais pas. Il faudrait faire l’inventaire des livres parus et soumis à compétition durant l’année, évidemment, mais je crains que pour ma part, il ne reste bientôt de ce livre qu’un grand flou et une idée générale : Bleu et Rouge se combattent et s’écrivent des lettres d’amour. Et ça me paraît un peu léger pour évoquer des images, des souvenirs, des archétypes. L’avenir me le dira.
24/2023 : De sang-froid
(Truman Capote)
 Dans la série « les classiques qu’il faut avoir lu », je vous présente « De sang-froid », de l’auteur américain Truman Capote. Mais pourquoi faut-il l’avoir lu, au fait, me suis-je demandé à la lecture de ce récit. Je ne peux que deviner : peut-être s’agit-il du premier fait-divers romancé, avec détails, de l’histoire de la littérature. En tout cas, le premier qui a marqué les esprits.
Dans la série « les classiques qu’il faut avoir lu », je vous présente « De sang-froid », de l’auteur américain Truman Capote. Mais pourquoi faut-il l’avoir lu, au fait, me suis-je demandé à la lecture de ce récit. Je ne peux que deviner : peut-être s’agit-il du premier fait-divers romancé, avec détails, de l’histoire de la littérature. En tout cas, le premier qui a marqué les esprits.
Car tout ce qui est écrit dans ce livre est « vrai », puisque le meurtre brutal de quatre membres d’une même famille à Holcomb, dans le Kansas est bien réel. Parce que les enquêteurs des différentes structures judiciaires qui ont suivi les rares pistes ont vraiment vécu. Car les deux coupables, retrouvés presque par hasard, sur des preuves assez faibles et qui ont heureusement rapidement avoué, sont réels, et ont bien été condamnés et exécutés. Tout était dans les journaux, les photos sont encore visibles sur Internet.
Reste la romance : le livre s’ouvre sur les dernières heures des victimes, se poursuit par l’équipée sauvage des tueurs et les doutes et découragements des enquêteurs. Et puis se termine sur le procès, la prison, la mort. Et c’est peut-être cette exhaustivité, parfois un peu forcée, qui fait le succès du livre. Pour la première fois, sans doute, en 1966, le grand public avait une vision complète d’un événement qui se produit, qui énerve et inquiète, et qui disparaît des mémoires. Un fait-divers, le nom lui-même, indique qu’il est à part, un événement unique (et pourtant toujours répété), un accident.
L’auteur tente de partager des éléments psychologiques des tueurs, prend le temps de dresser le portrait de tous les protagonistes, établit les moments déterminants dans la chronologie et fournit des informations de contexte pour mieux éclairer les faits. Mais à aucun moment l’auteur ne se place en juge. Il réagit en journaliste, précis, méticuleux, en apparence objectif (mais on ne l’est jamais) et place le lecteur face à un récit glaçant dont il peut, ou non, tirer des enseignements.
À notre époque, c’est chez Florence Aubenas qu’on trouve la meilleure incarnation de cet exercice, si ce n’est que le sens de la narration de cette dernière me semble plus développé (plus pernicieux, peut-être, allez savoir !) que chez Capote. Car il faut bien l’avouer, j’ai lu ce livre en plusieurs fois, étant souvent gagné par l’ennui du trop-plein, par le manque de mystère, au fond, pour le genre d’histoires qu’on connaît désormais bien à notre époque.
Parce qu’en 50 ans, on en a vu du fait divers. Du sordide, du terrifiant, de l’émouvant. On nous sert le fait-divers dans chaque épisode de série policière, dans les feuilletons criminels des médias, dans le quotidien. Et si on ne creuse plus systématiquement, c’est sans doute parce qu’on se lasse de découvrir toujours qu’au fond, il n’y a pas grand-chose à dire. Il y aura toujours les philosophes de la nature humaine, les colériques qui voudraient condamner tout le monde à mort, les humains qui se focalisent sur la victime, les pragmatiques qui veulent tourner la page. Alors, le fait-divers ponctue, et le livre de Truman Capote, s’il est cet alinéa qui commence un nouveau paragraphe, finit par être aussi invisible que cette marque typographique.
« De sang-froid » a sans doute été un catalyseur puissant à l’époque de sa parution, mais comme tout catalyseur, il n’est guère altéré par la réaction qu’il provoque. Il reste, monolithique témoignage, comme une borne sur la route de la société. Et c’est certainement pour cela qu’il faut l’avoir lu.
23/2023 : Ce monde disparu
(Dennis Lehane)
 J’avais perdu Dennis Lehane de vue. De manière incompréhensible, je suis passé à côté de bon nombre de ses publications de ces dernières années, jusqu’à croire qu’il n’avait plus rien écrit. Et c’est en vérifiant le CV de tous mes auteurs favoris que je me suis rendu compte que j’avais de la lecture en retard.
J’avais perdu Dennis Lehane de vue. De manière incompréhensible, je suis passé à côté de bon nombre de ses publications de ces dernières années, jusqu’à croire qu’il n’avait plus rien écrit. Et c’est en vérifiant le CV de tous mes auteurs favoris que je me suis rendu compte que j’avais de la lecture en retard.
« Ce monde disparu » est le troisième et dernier volume de la série consacrée à la famille Coughlin et plus particulièrement à Joe, devenu assistant de mafieux puis chef occulte. On le retrouve ici en Floride, où il a presque pris sa retraite et se contente de servir de conseiller aux familles italiennes. Mauvaise origine : lui est irlandais, et même sa réussite et son talent naturel pour débusquer les bonnes affaires ne lui a pas laissé la possibilité de monter en grade. Peu importe : Joe ne cherche pas la publicité. Ses affaires paraissent légales. Aussi, quand la mafia de Tampa commence à entrer dans une période de turbulence, il ne s’inquiète pas vraiment. Tout ceci ne le concerne plus. Aussi, quand une tueuse à gage en prison lui apprend, en échange d’un service, qu’il y a un contrat sur sa tête, il est d’abord dubitatif. N’est-il pas indispensable à la famille ? Qui peut bien vouloir l’abattre ? L’information est-elle juste ou fait-elle partie d’un écran de fumée pour cacher autre chose de plus sinistre ? Bien malgré lui, Coughlin va devoir enquêter et s’impliquer dans cette forme de politique à la mitrailleuse qui occasionnera un important bain de sang dans le milieu…
J’ai lu le second tome de la trilogie en 2014. Et je le trouvais meilleur que le premier. Il me semble donc que cette série se bonifie avec le temps, car « Ce monde disparu » est rempli de qualités. D’abord, centrer l’intrigue sur un personnage permet une fois de plus de s’y attacher, malgré son compas moral forcément douteux. Ensuite, on est en plein dans un mystère politique, une enquête, cette fois du côté criminel. Enfin, l’auteur sait toujours aussi bien jongler entre lecture factuelle et émotionnelle – ça a toujours été sa grande qualité – et on se retrouve face à de magnifiques scènes chargées de tristesses ou de colères. Car ce dernier tome est avant tout une belle histoire de trahison, et interroge sur la trace que l’on laisse dans le monde des vivants, l’héritage familial et tout simplement historique. Tandis que les têtes tombent, il reste des innocents flétris.
Mais impossible de finir cette fiche sans évoquer à nouveau le sixième sens cinématographique de l’auteur : ses choix de décors, le rythme de ses scènes, les dialogues précis et tranchants, tout cela pourrait être transposé tel quel à l’écran, et a sans doute justifié des très bonnes adaptations de ses œuvres déjà réalisées. Une fois de plus, on peut dénombrer quelques scènes vraiment réussies, impressionnantes au sens « développement photographique » du terme. La montée en puissance de l’intrigue sert l’émotion et vice-versa, c’est toujours un plaisir de retrouver du bon Dennis Lehane. Heureusement, il m’en reste à découvrir !
22/2023 : Ronde de nuit
(Terry Pratchett)
 Attention : chef-d’œuvre. « Ronde de nuit » est le 28ème (!) livre de la série du Disque-Monde, une série que j’avais déjà enterrée depuis longtemps et que je poursuivais à titre de divertissement et d’exhaustivité, m’attendant à une progressive perte de qualité. Et puis, patatras (ça vaut bien perlimpinpin) ! C’est assez remarquable que Pratchett ait réussi, tout en restant fidèle et cohérent à son univers, à y insérer cette pépite riche et équilibrée, puisant à différentes sources, pour surprendre le lecteur.
Attention : chef-d’œuvre. « Ronde de nuit » est le 28ème (!) livre de la série du Disque-Monde, une série que j’avais déjà enterrée depuis longtemps et que je poursuivais à titre de divertissement et d’exhaustivité, m’attendant à une progressive perte de qualité. Et puis, patatras (ça vaut bien perlimpinpin) ! C’est assez remarquable que Pratchett ait réussi, tout en restant fidèle et cohérent à son univers, à y insérer cette pépite riche et équilibrée, puisant à différentes sources, pour surprendre le lecteur.
Pourtant, l’histoire commence « normalement ». Rapidement, on se rend compte que la thématique du livre sera la « vie de policier », et on s’attend à l’inévitable déclinaison des clichés qui font la marche de fabrique des livres inférieurs de la série. Vu que les premiers chapitres sont centrés sur un commissaire Vimaire du Guet de Ankh-Morporck vieillissant et proche de la retraite, on s’attend à entendre du saxophone ponctuer des « je suis trop vieux pour ces conneries » jusqu’au bout du récit. Et puis, alors que Vimaire, pris d’un accès de jeunesse, s’en va poursuivre un criminel sans foi ni loi sur les toits de l’Université Invisible, un éclair frappe et le projette, ainsi que son adversaire, dans le passé de la ville, au temps de la jeunesse de Vimaire. Isolé dans ce monde qui appartient au passé, il continue à traquer son adversaire tout en se retrouvant confronté à d’autres difficultés : comment ne pas abimer le temps, comment enseigner quelques sagesses au jeune écervelé qu’il était, et surtout, comment faire face à une révolution qui commence en ville, où de puissantes factions se mènent une guerre de l’ombre pour le contrôle de la ville.
C’est donc une parfaite alliance entre « l’arme fatale », « retour vers le futur » et « Vidocq ». Ce qui est étonnant, c’est que pour une fois l’humour absurde de situation, les non-dits parfois lourds et les petites blaguounettes laissent la place à une intrigue et une réflexion mature sur « le temps qui passe et reste le même ». On retrouve bien quelques personnages du guet, mais la plupart du temps, on est dans la tabula rasa, un domaine peu exploré par le passé dans la série, même s’il était bien question de-ci et de là de révoltes citadines passées. Ajouté à l’aspect « police secrète », tortures et individus sans scrupules, véritables porte-flingues des puissants, on s’approche d’une ambiance « Amérique du Sud » assez malsaine et terrifiante, inhabituelle dans la série.
Mais là où l’ouvrage acquiert une force qui résonne puissamment en 2023, c’est que Pratchett y introduit une vraie et solide réflexion sur le maintien de l’ordre et la loyauté, et semble indiquer que plus que la force, c’est la psychologie, la bienveillance et l’exemple qui amènent le calme et l’ordre. Tandis que les « forces de l’ordre » et les manifestants se heurtaient à Sainte-Soline, ces moments subtils prennent tout leur sens et interrogent sur l’intelligence de nos dirigeants… que Pratchett vouerait à l’échec s’ils empruntaient la même voie dans son récit !
Quand, au bout des 450 pages habituelles, l’histoire est bouclée, on a l’impression d’avoir vécu une aventure singulière, divertissante et intelligente – ce qui n’a pas toujours été le cas, même si Pratchett a bien d’autres réussites à son actif. On a ri, et puis derrière le rire, on s’est un peu interrogé. Et tout un livre centré sur Vimaire permet, sans doute une dernière fois, de faire un zoom sur un personnage intéressant, non-conformiste, humaniste et malin. Comme on aimerait en voir plus souvent dans la vraie vie !
21/2023 : Le tonneau magique
(Bernard Malamud)
 « Stop ou encore ? ». J’ai choisi « encore » après avoir lu « Le commis » et « L’homme de Kiev », deux romans de Malamud. Cette fois, je me suis plongé dans le recueil de nouvelles « le tonneau magique » qui confirme que l’auteur est autant à l’aise dans la forme courte que dans la forme longue. Composé de 13 textes d’une vingtaine de pages en moyenne, l’ouvrage décline différents thèmes récurrents, avec un registre allant du sentimentalisme mélancolique, l’humour absurde ou encore la culpabilité.
« Stop ou encore ? ». J’ai choisi « encore » après avoir lu « Le commis » et « L’homme de Kiev », deux romans de Malamud. Cette fois, je me suis plongé dans le recueil de nouvelles « le tonneau magique » qui confirme que l’auteur est autant à l’aise dans la forme courte que dans la forme longue. Composé de 13 textes d’une vingtaine de pages en moyenne, l’ouvrage décline différents thèmes récurrents, avec un registre allant du sentimentalisme mélancolique, l’humour absurde ou encore la culpabilité.
Si le premier texte est une forme courte et abrégée du Commis (et donc, une redite), les autres nouvelles explorent l’humain, ses contradictions, ses limites et ses faiblesses. On y trouve souvent le thème du regret, quand des personnages se rendent compte trop tard qu’ils ont été injustes ou tout simplement vils, et sont pris de remords quand il est trop tard pour réparer. La fameuse tache sur la conscience qui plonge le personnage dans un silence coupable et méditatif.
Trois des textes se déroulent en Italie, et il faut bien dire que, s’ils sont plutôt dans le registre comique, ces textes semblent associer le pays de manière caricaturale à du baratinage et des petites arnaques. On sent ici un traumatisme non résolu chez l’auteur !
Sinon, c’est clairement la tristesse du temps qui passe et de la misère de la nature humaine qui prédomine : des commerçants juifs criblés de dettes qui soupirent face à l’injustice et en viennent à commettre des actes qu’ils regrettent pour se maintenir à flots. De curieux pactes qui se terminent mal, où un simple mensonge originel crée une situation pénible et insoluble. Mais tous ces récits posent en filigrane la question de l’attitude qu’il faut avoir envers son prochain, que ce soit un vieux grincheux, un arnaqueur harceleur, un voisin dans le besoin ou un vieil ami devenu embarrassant.
Explorant les conséquences de ces dilemmes, Malamud paraît découvrir une malédiction divine : nos choix nous engagent, et chaque choix peut être regretté à un moment ou un autre, comme s’il n’y avait pas de « voie royale », pas de chemin simple. La vie est une épreuve dès lors qu’on se pose des questions, qu’on se projette dans le passé ou le futur ; qu’on choisit d’aider ou non, il semblerait qu’on finisse par le regretter sur terre. Quant à ce qui se passe après, Malamud ne s’engage pas : c’est affaire personnelle.